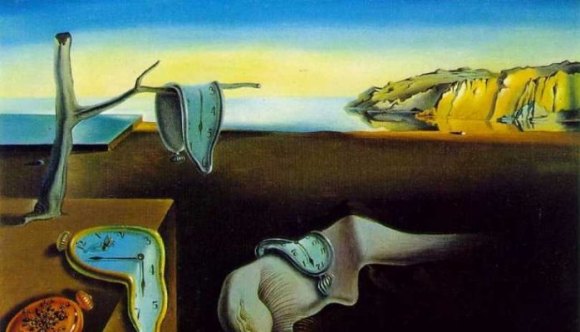Audace, inventivité, souplesse, authenticité… Tout le monde s’accorde à dire que nos entreprises doivent se réinventer pour se différencier. Quand on parle d’innovation, on pense stratégie, offre, organisation et très rarement management, à savoir la manière dont on anime et les Hommes. Pourquoi ?
Vous, qui découvrez cet article, aimeriez-vous travailler au sein d’une entreprise où :
- les missions que l’on vous confie sont passionnantes ?
- les relations sont authentiques et basées sur la confiance ?
- vous disposez d’un niveau d’autonomie et de liberté suffisant ?
- les équipes sont solidaires et les collaborations entre services constructives ?
Est-ce le cas ?
Bien que 85 % des dirigeants estiment que l’innovation est primordiale pour rester compétitif, les entreprises n’y accordent qu’environ 10 % de leur temps [i]. Si 54 % des collaborateurs suggèrent de nouvelles idées à leurs managers, seulement 11 % d’entre elles sont prises en considération [ii].
Le management : parent pauvre de l’innovation
Selon un sondage Ipsos de 2013, l’innovation est confiée à 72 % aux fonctions Recherche & Développement, Qualité et Marketing, ce qui représente entre 5 à 8 % de l’effectif. Les autres fonctions ne seraient-elles pas concernées par la recherche de nouvelles idées ?
Quand on parle d’innovation, on pense en premier lieu aux innovations technologiques ou à la création de nouvelles offres. D’ailleurs, les classements des entreprises innovantes sont basés sur le nombre de brevets déposés et en cela, il est vrai, la France est le 3ème pays le plus innovant au Monde [iii].
Mais très rares sont les décideurs qui parlent d’innovation managériale.
Et lorsqu’il est état d’innovation managériale, les évolutions portent avant tout sur l’organisation et les systèmes d’information. Les « principes collaboratifs » arrivent en dernière position alors que c’est très certainement dans cette direction que se situe la véritable (r)évolution du management.
En effet, il ne suffit pas de « greffer » une nouvelle théorie de management pour qu’elle prenne, il faut que tout le corps l’accepte. Si Toyota est l’exemple par excellence du Lean management, on ne peut pas en dire autant d’autres entreprises pour lesquelles cette expérience s’est soldée par un véritable fiasco. Quelle en serait la raison ? Tout simplement parce que, chez Toyota, le Lean management n’est pas une méthode mais une philosophie, une manière de fonctionner et de se comporter fortement ancrée chez tous les salariés, quelles que soient leurs responsabilités.
Histoire du management : quand « toujours plus de la même chose produit les mêmes effets »
Si les outils évoluent, les paradigmes managériaux demeurent inchangés depuis un siècle. Certes, les niveaux hiérarchiques se sont réduits mais les processus décisionnels restent identiques (c’est toujours le « chef » qui décide). Si l’on demande aux collaborateurs d’être plus autonomes et force de proposition, les outils de management sont toujours « descendants ». Les salariés sont sans nul doute mieux formés et plus compétents mais on attend toujours d’eux qu’ils restent dans le « cadre » de leur description de poste. La stratégie reste encore le privilège de la gouvernance etc.
Au fond, quel que soit le nom qui lui a été attribué au fil des années (patron, chef, cadre, leader…) le manager a toujours pour rôle principal de prescrire et de contrôler le travail de son équipe (quand il en a le temps).
Si les grands penseurs du management étaient encore parmi nous (F-W Taylor, H. Fayol, P. Drucker, E. Deming…), ils s’étonneraient sans doute de constater que leurs modèles sont encore d’actualité alors que le monde a considérablement changé depuis 10 ans.
Certains se demanderaient même pour quelles raisons nos entreprises n’ont retenu que les aspects organisationnels de leurs préconisations sans avoir pris en considération les dimensions relationnelles. Saviez-vous que si H. Fayol préconisait « l’unité de direction » et « la division du travail », il soulignait également l’importance de « l’initiative des salariés » et « l’union du personnel » ? Pour quelles raisons ces dimensions n’ont pas été intégrées par la quasi majorité des entreprises françaises ?
Comparé aux changements considérables des autres domaines de vie (technologie, géopolitique…), le management semble avancer au rythme d’un escargot.
Innovation managériale : de la logique à l’intuition
Pendant près d’un siècle tous les modèles de management ont été élaborés sur la base de la pensée logique : Comment augmenter la productivité, conquérir des parts de marché, améliorer la qualité et plus récemment lutter contre la concurrence par la diminution des coûts ? Autant de questions qui ont amené des réponses rationnelles, basées le plus souvent sur des fondements statistiques et mathématiques qui constituent le cœur des enseignements en management dispensés au sein de nos grandes écoles (si on veut augmenter la production, il faut embaucher et si on veut diminuer les charges, licencier, CQFD).
Rien d’étonnant alors à ce que la plupart de nos dirigeants raisonnent encore comme tel puisqu’ils reproduisent ce qu’il leur a été enseigné par des professeurs, consultants, eux-mêmes fortement imprégnés de ce mode de pensée (il suffit pour vous en convaincre de regarder le contenu des formations de nos élites).
Et si les entreprises ont intégré la dimension motivationnelle dans les années 80, ce fut avant tout pour augmenter la productivité (en référence à l’expérience de la Western Electric des années 1930), rarement pour contribuer au bien-être de leurs collaborateurs. De même, la prévention des risques psychosociaux n’est pas à l’initiative des entreprises mais du gouvernement suite à la médiatisation des suicides chez France Télécom (même si quelques rares entreprises s’étaient engagées dans cette démarche avant 2009). Mais au fond, l’entreprise a-t-elle pour vocation de rendre les gens heureux ou de gagner un maximum d’argent ?
Si le management est le parent pauvre de l’innovation, c’est très certainement du au fait que cette dimension est la plus difficile à faire évoluer (un changement de technologie prend entre 6 et 18 mois, un changement culturel entre 1 et 5 ans). Mais difficile ne signifie pas pour autant impossible car cette difficulté ne réside pas dans la capacité à s’ouvrir à de nouvelles idées mais à se libérer des idées anciennes.
Innover en matière de management ne repose plus sur l’adoption de concepts sortis tout droit d’Harvard ou pensés par des grands gourous américains. Bien au contraire, les pratiques managériales qualifiées d’innovantes proviennent des entreprises elles-mêmes et sont davantage le fruit de convictions de leaders, de paris un peu fous en réponse à une situation de crise, de bon sens, d’échanges entre personnes, d’expérimentations audacieuses pour la grande majorité antagonistes à tout ce que vous avez pu connaître jusqu’à présent pour la simple et bonne raison que nos anciens modèles sont devenus inopérants, voire contre productifs.
Les innovations managériales que vous allez découvrir peuvent être classées dans la catégorie dite de « l’innovation de rupture ». Elles sont soit antagonistes, à savoir contraires aux pratiques courantes (augmentations de salaires décidées entre collègues, stratégie d’entreprise pensée par les collaborateurs), soit « intégratives », c’est-à-dire en réponse aux valeurs, modes de pensée et comportements émergents de notre société (auto déclaration de son humeur, valorisation de l’erreur…).
L’innovation managériale : plus facile à dire qu’à faire
La première étape de l’innovation managériale est sans conteste l’acceptation que cet exercice est très difficile, et ce, pour 4 principales raisons :
1. L’ancrage des certitudes : qu’il est difficile de remettre en cause ce que l’on considère comme une vérité absolue !Souvenez-vous cependant que nos ancêtres étaient certains que la terre était plate et que le soleil tournait autour de notre planète et que tous ceux qui contestaient ces points de vue risquaient de le payer de leur vie. La seule certitude que vous pouvez avoir est que manager en 2014 n’a rien à voir avec la manière dont les équipes étaient dirigées en 1924 et que le management du XXIIème siècle sera bien différent de ce que nous connaissons (si tant est qu’il existe encore une mission de management).
2. La peur : de perdre le contrôle, du pouvoir, de faire des erreurs. Penser autrement c’est forcément prendre un risque, tout simplement car il n’est pas possible de se référer à quelque chose d’existant. Et dans notre pays, le risque est synonyme de danger. Dans d’autres, la prise de risque est perçue comme du courage et une opportunité.
3. La pression sociale : beaucoup de personnes renoncent à une idée au motif qu’elle est dite irréaliste ou qu’elle sera rejetée par les autres. Or l’innovation managériale est avant tout une affaire de conviction et ne doit pas dépendre du regard des autres dont la tendance est, dans notre pays, plutôt au pessimisme (nous sommes les champions du Monde en la matière selon un récent sondage mené par Gallup), à la critique et au conformisme (jusqu’à ce que l’on ait la preuve que ça marche !).
4. Les limites du raisonnement : Dur de penser autrement. Comment faire ? Il existe une croyance populaire : la créativité est un don et dépend de la personnalité. Heureusement, cette pensée est totalement fausse. La créativité est une capacité, donc elle s’apprend !
S’engager dans des démarches d’innovation managériale suppose avant tout d’apprendre à désapprendre.
Tour du Monde des pratiques managériales innovantes
Selon Benjamin Chaminade, la créativité passe par 4 étapes. La première est l’Inspiration. C’est pourquoi, plutôt que de vous assener de convictions et de théories, nous avons préféré vous présenter quelques exemples d’innovations managériales adoptées par des entreprises de tailles, secteurs et nationalités différentes. Toutes ont néanmoins un point commun : elles sont parvenues à concilier épanouissement et performance !
Voici quelques pratiques innovantes classées en 6 leviers en fonction de l’ordre d’importance accordé par les entreprises françaises (la confiance, l’engagement, le bien-être, l’agilité, la collaboration et la créativité).
La confiance
« L’homme supérieur est celui qui d’abord met ses paroles en pratique et ensuite parle conformément à ses actions » – Confucius
« On ne nous dit pas tout », « Il n’a pas respecté sa promesse », « Il paraît qu’il va y avoir une fusion », « Notre concurrent a licencié 20 % de ses salariés, à quand notre tour ? »… Promesse non tenue, avenir incertain, changements abscons, informations opaques, peur d’être mal jugé… autant de raisons qui ont, ces dernières années, créé un élan de méfiance au sein des entreprises. Or point de seine et profitable collaboration sans confiance.
(Ré)instaurer la confiance au sein des entreprises suppose de respecter quelques critères tels que le respect des engagements, la crédibilité du management, la fiabilité et la transparence des informations, la congruence entre les actes et les propos ou encore l’encouragement et l’acception d’expression d’insatisfactions ou de doutes.
Au fond, cela revient tout simplement, d’une part, à se faire confiance puis à faire confiance aux autres. Sur le papier, tout le monde le souhaite. Mais comment y parvenir ?
3 exemples d’innovations managériales qui renforcent la confiance
- En France, Chez Mars Chocolat, Thierry Gaillard, PDG, organise toutes les 6 semaines une réunion de 30 minutes, intitulée « Ca se discute », où il répond à toutes les questions des collaborateurs. Cette pratique est d’autant plus intéressante lorsque l’on sait que les salariés ont beaucoup moins confiance en leurs dirigeants qu’en leurs managers directs.
- En Inde, chez HCL Technologies, les salariés peuvent exprimer leurs doutes et leurs interrogations via un forum interne intitulé « U&I » (vous et moi) aux membres de la direction qui s’engagent à répondre, le PDG y compris, quitte à répondre qu’ils ne savent pas. Instaurer la confiance suppose de passer par une étape incontournable et pas toujours agréable pour le management : autoriser l’expression des doutes, craintes ou critiques. Mieux vaut canaliser leurs expressions que de les laisser se répandre dans les couloirs, autour de la machine à café ou chez les clients.
- En Californie, l’éditeur de logiciel Intuit organise ce qu’il appelle la « fête de la défaite » au sein de laquelle sont évoqués les échecs de manière à « tourner collectivement la page » et apprendre de ses erreurs. L’erreur est humaine, alors pourquoi la nier ? Mieux vaut accepter les échecs et en tirer parti que de les renier et les laisser assombrir l’ambiance et altérer la confiance.
Engagement et responsabilisation
« Le meilleur manager est celui qui sait trouver les talents pour faire les choses, et qui sait aussi réfréner son envie de s’en mêler pendant qu’ils les font » -
T. Roosevelt
« Ce n’est pas à moi de le faire », « Je ne suis pas payé pour ça », « J’avais dis que ça ne marcherai pas », « C’est de la faute de la comptabilité »… Autant de propos qui déstabilisent les managers qui ne comprennent pas pourquoi leurs collaborateurs ne s’investissent pas autant dans leur travail qu’eux.
La conscience professionnelle appartiendrait-elle au passé ?
Selon une enquête internationale Gallup, environ 11 % des salariés se déclarent « engagés » (motivés, volontaires), 61 % sont « non engagés » (il font juste ce qu’on leur demande) et 28 % seraient « activement désengagés (ils ont une vision négative de leur entreprise et peuvent aller jusqu’à aller à l’encontre de son intérêt s’il le faut). Ces chiffres n’ont pas beaucoup évolués en 10 ans.
Le sens des responsabilités nait avec l’engagement. Autrement dit, je me sens responsable de ce que j’ai décidé, pas forcément de ce que l’on a décidé pour moi. Or, pour être honnête, il est rare que les collaborateurs décident de leurs missions ou de leurs objectifs. La marge de manœuvre des collaborateurs réside davantage dans le « comment » que dans le « quoi » (définition de l’objectif par le collaborateur).
Tant que les collaborateurs ne seront pas pleinement impliqués dans la définition de ce qui leur est demandé, nous maintiendrons un système managérial infantilisant ou le manager, en bon père, récompensera les succès et punira (soit par une absence de récompense, soit par une sanction) les échecs, non conformités ou insuffisance professionnelles.
Et c’est justement la crainte d’être « puni » qui freine la responsabilisation. Cette épée de Damoclès est bien souvent à l’origine des tensions entre managers et collaborateurs. Les concepts « 0 défauts », « qualité totale » ou autres injonctions à l’excellence positionnent les salariés en position défensive (c’est pas ma faute !) alors que la valorisation de l’erreur (à condition qu’elle ne soit ni volontaire, ni répétitive) permet d’insuffler une culture de l’amélioration continue (à condition d’avoir réinstauré préalablement un « climat de confiance »).
3 exemples qui permettent de renforcer l’engagement et la responsabilisation
- En France, chez Leroy Merlin, la stratégie est élaborée par les salariés par le biais de nombreuses rencontres intégrées dans une démarche intitulée « Vision ». Au démarrage de ce projet, tous les collaborateurs ont contribué à la concrétisation de cette stratégie dans cette entreprise où « il fait bon travailler ». Chaque collaborateur se sent concerné par la réalisation de ce projet. Sans doute le fait que tous les collaborateurs de Leroy Merlin soient actionnaires de leur entreprise contribue-t-il aussi à ce que chacun se sente responsable des résultats dont les bénéfices sont par ailleurs répartis de manière équitables entre tous les salariés ?
- Aux Etats-Unis, chez Morning Star, entreprise de transformation de tomates de près de 700 salariés, les collaborateurs négocient leurs objectifs entre eux, en fonction de leurs idées respectives et de ce qu’ils pensent bon pour leur entreprise. Pas de chef pour leur dire ce qu’ils doivent faire. Ces négociations aboutissent à des « contrats d’engagement » accessibles à tous les collaborateurs. Cette pratique se différencie de la fixation d’objectifs car les auteurs de ces engagements sont les acteurs qui les mettront en œuvre.
- En France, la compagnie aérienne Air France a instauré il y a quelques années une « charte de non punition de l’erreur ». Après avoir pris conscience et accepté que l »une des principales causes d’accidents et d’incidents était d’origine humaine, et compte tenu des conséquences, cette compagnie aérienne a décidé d’encourager ses collaborateurs à exprimer (sous anonymat) leurs erreurs et signaler des dysfonctionnements en contrepartie de quoi elle s’est engagée à ne pas pratiquer de sanction lorsque les erreurs étaient révélées et assumées. La seule sanction envisagée concerne les salariés qui n’auraient pas fait part de leurs erreurs.
Le plaisir et le bien-être
« Choisissez un travail que vous aimez et vous n’aurez pas à travailler pas un seul jour de votre vie » – Confucius
« Il est vrai que mon job n’est pas très passionnant mais il me permet de nourrir ma famille », « J’ai fais le tour de mon poste, que me proposez-vous ? », « Mon manager n’est pas motivant »… Si environ 80 % des Français sont satisfaits de leurs conditions de travail (locaux, horaires, niveau d’autonomie…)[iv], seulement 20 % considèrent leur travail comme une source de plaisir [v]. Peut-être est-ce du au fait que 46 % des Français ne travaillent pas dans la fonction désirée [vi] ?
Quel intérêt à une entreprise à ce que ses salariés soient heureux au travail ?
Avant la médiatisation des suicides en 2009, le bien-être au travail n’était pas vraiment un sujet de préoccupation des dirigeants. Et si les entreprises ont eu à cœur de motiver leur personnel, c’est sans doute pour augmenter la performance, pas vraiment pour leur bien-être. Ces propos peuvent sembler choquants. Et pourtant, dans notre société, il semble bien que le social soit encore au service de l’économique, et non l’inverse.
Mais contrairement à ce que l’on pense, l’amélioration des conditions de travail agissent sur la satisfaction, ils n’augmentent pas le plaisir au travail.
Mais qui est responsable du plaisir ressenti par chaque salarié ? L’entreprise ? Le salarié ? Les deux ? A priori, tout dépend dans un premier temps de ce que recherche le salarié.
D’après nos études, le plaisir au travail repose principalement sur 2 facteurs :
- Le contenu des activités et les responsabilités confiées,
- la convivialité et la bonne ambiance entre collègues.
Si l’entreprise peut agir sur ce second facteur, le premier dépend du ressenti qu’éprouve le salarié à réaliser ses missions. Il s’agit donc d’un facteur endogène qui relève du seul choix professionnel du collaborateur (alors que trop de salariés estiment qu’il appartient à l’entreprise de les rendre heureux).
C’est pourquoi, le bien-être et le plaisir au travail ne peuvent être à la seule initiative de l’employeur.
Il s’agit d’une co-responsabilité.
3 exemples de pratiques qui renforcent le bien-être et le plaisir au travail
- Au Brésil, les ouvriers des usines de Fiat déclarent chaque matin leur humeur, au moment de leur prise de poste : vert, si tout va bien; orange, s’il est moyennement motivé et rouge s’il rencontre un problème. Les salariés qui se déclarent en rouge sont alors reçus par un manager et un spécialiste de la fonction R.H. (environ 80% des ouvriers se déclarent en rouge une fois par an). Cette pratique est particulièrement intéressante dans la mesure où l’entreprise autorise et confie la responsabilité de la déclaration d’un mal-être au salarié (et non au management).
- Aux Etats-Unis, au sein de l’entreprise WL Gore (près de 8 000 salariés), les nouveaux embauchés disposent de quelques semaines pour faire le tour des projets et choisir les équipes avec lesquelles ils aimeraient travailler en fonction du plaisir qu’ils ressentent à contribuer au projet. Les équipes plébiscitées peuvent accepter ou refuser la candidature. Cette pratique met clairement en avant les 2 principes du plaisir au travail, à savoir l’intérêt du travail et l’appartenance à un groupe au sein duquel on se sent bien.
- En France, chez Euro Disneyland Paris, cette entreprise d’environ 15 000 salariés a institué un « Conseil Municipal » constitué de collaborateurs bénévoles en charge de trouver des solutions aux « petits tracas quotidiens » décelés par des « animateurs de quartier » (relais d’informations). Cette communauté se réunit 4 fois par an en dehors des réunions institutionnelles encadrées par la réglementation sociale.
Agilité & Liberté
« Une entreprise sans ordre est incapable de survivre, mais une entreprise sans désordre est incapable d’évoluer » B. Nadoulek
» Désolé, Monsieur le client, je ne peux pas vous répondre, cette décision dépend du siège et je n’ai pas les informations », » On a toujours fait comme ça, pourquoi changer ? », » Ici c’est Versailles, aucun collaborateur n’a de réelle autonomie. Toutes les décisions sont centralisées au Comité de Direction ». La plupart de nos entreprises sont encore organisées selon les bons vieux principes du Taylorisme, à savoir une organisation structurée par métiers, un pouvoir décisionnel centralisé, encadré par des fiches de poste issues d’une classification longuement négociée, le respect absolu des procédures dont la conformité est confiée à l’autorité hiérarchique.
Ce dont certains dirigeants n’ont pas conscience c’est que ce mode de fonctionnement était parfaitement adapté à un monde linéaire et prévisible mais devient contreproductif dans une société de plus en plus complexe, en permanente mutation et imprévisible.
Qualité totale, maîtrise des coûts, des risques…Le niveau de précision de ce qui doit être fait et le formalisme qui en découle (règles, procédures, formulaires…), ainsi que les outils de contrôle et de reporting associés permettent à l’évidence de garantir la conformité mais génèrent un niveau de rigidité et de lourdeur administrative qui freinent la réactivité de nos entreprises.
Pire, celles qui voudraient se libérer de ces chaînes avouent leur impuissance à le faire, contraintes qu’elles sont par la multitude de normes imposées, soit par l’Etat, soit par leur secteur ou leurs clients (ISO, marché public, RSE, Solvency, Bâle…).
Et pourtant, la différence entre entreprises concurrentes se joue à présent en grande partie sur leurs capacités à faire preuve de réactivité, voire de proactivité. Il leur faut se libérer des anciennes méthodes de management, fondatrices de superbes usines à gaz, et renouer avec le bon sens (se concentrer sur les activités créatrices de valeurs), la simplicité (réduire le nombre de procédures et chasser les activités sans valeur ajoutée…), la débrouillardise (apprendre à faire plus avec moins, partir des contraintes…), modifier leurs structures (organisation par client ou par produit), offrir plus de liberté dans la manière de réaliser les missions (nomadisme, télétravail…) en redonnant du sens, mobilisant autour de valeurs partagées pour se concentrer essentiellement sur les résultats.
3 exemples de pratiques qui renforcent l’agilité et la liberté
- En France, sous l’impulsion du Colonel Marlot, directeur du Centre des sapeurs pompiers de Saône et Loire (environ 2 500 personnes), un « réseau d’intelligence territoriale (R.I.A.) a été institué, en complément de l’organigramme institutionnel en vue de résoudre des « problématiques sans solution connue ». Cette instance a pour objectif de mobiliser « l’intelligence des foules ». Aussi, ceux qui y participent acceptent de laisser leurs grades, fonctions, anciennetés au début de la réunion de manière à garantir un maximum de liberté d’expression.
- Au Brésil, au sein de la société Semco (plus de 3 000 salariés), les collaborateurs qui le désirent (environ 75 %) sont libres de se fixer eux-mêmes leurs salaires, de venir travailler quand ils le souhaitent, de s’organiser comme ils l’entendent, à condition toutefois de s’engager sur un résultat et de l’atteindre. La contrepartie de cette liberté ? Respecter son engagement. Et pour ceux qui s’amuseraient à ne pas le faire, ils devront rendre des comptes, non pas à leur hiérarchie mais à toute l’entreprise.
- En France, chez Poult, pour faire face à une situation financière alarmante en 2007, les salariés ont décidé de s’affranchir de certaines missions support (gestion du temps, des stocks…), de se les partager en plus de leurs missions de manière à se recentrer sur la création de nouvelles valeurs. Le reporting a été simplifié et chacun est libre d’explorer de nouvelles idées et de les partager sans contraintes hiérarchiques ou fonctionnelles avec ses collègues.
Collaboration
« Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts » – I. Newton
« Expliquez-moi pourquoi la direction nous parle de solidarité alors que chaque directeur passe son temps à défendre son territoire », « Avec une organisation en silos, rien d’étonnant à ce que chacun reste dans son coin », « On a grandit tellement vite qu’on ne sait plus qui est qui dans cette maison », « Ici, c’est chacun pour soi ». La division du travail n’a pas seulement pour conséquence de freiner l’agilité, elle altère aussi la relation.
Il est fréquent de constater un phénomène de « starisation » de certaines fonctions qui peut parfois aller jusqu’à l’instauration d’une sorte de compétition entre métiers. Cet effet est accentué par les restrictions budgétaires (chaque fonction doit « défendre sa paroisse ») ou encore les politiques de récompenses individuelles (pourquoi a-t-il été promu et pas moi alors que j’ai mieux travaillé ?).
La primauté du résultat, le cloisonnement induit par la division du travail, la prédominance bureaucratique et la centralisation du pouvoir ont altéré la qualité de la collaboration.
L’innovation managériale consiste à recréer du lien, de la proximité, mobiliser l’intelligence collective, autoriser chacun à s’exprimer, donner un avis sur un procédé, une personne, renforcer les liens entre entités et instaurer des moments de convivialité au sein d’un service, entre directions et au niveau de toute l’entreprise.
l existe de nombreuses manière de retrouver ce qui a été perdu : les espaces collaboratifs, le coaching d’équipe, les ateliers de co-devéloppement, les « vis ma vie », les évaluations étendues ou encore « l’open innovation ». Car la collaboration ne se borne pas à l’entreprise, elle s’étend à présent aux relations avec ses partenaires, ses clients, voire ses concurrents (concept de coopétition).
3 exemples de pratiques qui renforcent la collaboration et la cohésion
- Aux Etats-Unis, chez Zappos, cette entreprise de vente en ligne de chaussures de 2 000 salariés a grandit tellement vite que les personnes ne se connaissaient plus. Soucieux de préserver la convivialité et la proximité entre ses équipes, son P.D.G., Tony Hsieh, a fait développer une application informatique qui consiste à présenter, lors de sa connexion sur son ordinateur chaque matin, une photo d’un collaborateur et demander à choisir entre 3 noms. Une fois le choix effectué (qu’il soit bon ou non, peu importe) la fiche de présentation du collaborateur apparait alors. Cette pratique, unique au monde, permet de renforcer la connaissance des collaborateurs dans un contexte de fort développement ou d’éloignement des effectifs.
- En Inde, chez HCL Technologies, société de services informatiques d’environ 80 000 personnes, son P.D.G., Vineet Nayar, a institué un dispositif intitulé « Feed Forward ». Sur la base du volontariat, chacun peut communiquer, quand il le veut, un feed-back sur les compétences qu’il apprécie et celles qu’il conseille de développer/renforcer chez un collègue avec lequel il a été amené à travailler, sans pour autant s’inscrire dans un processus formel. Cette démarche est anonyme et bien évidemment bienveillante. L’idée est, après avoir énoncé les aspects positifs, de permettre à un collaborateur volontaire de bénéficier d’un effet miroir sur ses axes de développement professionnel en dehors des évaluations hiérarchiques traditionnelles.
- En France, la S.N.C.F. a institué une « communauté managériale » via un portail accessible à tous les encadrants. Au sein de ce portail, les managers peuvent partager une problématique, échanger sur leurs pratiques et même composer un numéro de téléphone direct afin de bénéficier d’un soutien ou d’un conseil par un expert autre que son manager. Cette pratique est particulièrement intéressante au sein d’entreprises où les managers sont tellement cloisonnés dans leurs fonctions qu’ils se retrouvent seuls à faire face à des situations managériales dont ils ne trouvent pas de solutions. Elle permet de renforcer les liens entre managers qui partagent des problématiques communes, bien qu’ils exercent des métiers différents. L’opportunité de pouvoir partager entre collègues encadrants permet également une plus forte transparence dans les échanges, ce qui n’est pas forcément le cas avec la hiérarchie (crainte d’être mal vu, sensibilité de certains sujets…).
Créativité & Innovation
« La difficulté n’est pas de comprendre les idées nouvelles mais d’échapper aux idées anciennes » J-M Keynes
« Je n’ai jamais de retour de ma hiérarchie concernant les idées que je lui propose », « De toute façon mes idées, je vais les proposer ailleurs parce qu’ici on ne nous demande d’être des moutons », « J’ai compris, je ne propose plus rien car à chaque fois mon manager s’approprie mon idée », « On nous demande d’être innovants mais on ne nous accorde pas de temps pour réfléchir ». Et pourtant, tout le monde sait que de nos jours la différence se joue sur la capacité d’une entreprise à se différencier de ses concurrents par l’innovation.
Les gouvernances prônent l’audace, la créativité, le « out of the box » mais ne changent rien à leurs pratiques et leurs modes de management.
Beaucoup se sont engagées dans la mise en œuvre de plateformes d’expression d’idées mais les règles de gestion sont encore trop cadrées, les avis sont confiés à des experts qui parfois jugent en fonction de leur expérience et non des « signaux faibles » et tendances émergentes. La maîtrise des risques est-elle incompatible avec l’audace ? Pourquoi l’innovation est-elle encore confiée exclusivement aux fonctions recherche et développement ? Qu’est-ce qui empêche les entreprises d’ouvrir au plus grand nombre l’expression d’idées ?
L’innovation est une démarche spatiotemporelle :
- « Spatio » : l’innovation doit être transfonctionnelle et ouverte au plus grand nombre car tout le monde peut avoir des bonnes idées, quel que soit son métier, son statut ou son expérience. Il s’agit davantage aujourd’hui de mobiliser la « sagesse des foules » que de restreindre la recherche de nouvelles idées aux experts. Ouvrir au plus grand nombre permet d’instaurer un processus d’itération qui permet aux personnes de se nourrir les unes les autres (une idée en amène une autre qui en amène au autre…). Saviez-vous que l’idée d’utiliser une carte dans les chambres d’hôtels pour éviter les dépenses d’électricité vient d’un homme de ménage ?
- « Temporelle » : les idées surviennent à tout moment, que ce soit pendant ou en dehors du temps de travail (sous la douche, dans les transports, au cinéma…). Par conséquent, restreindre l’exploration de nouvelles idées à une réunion de 2 heures n’a plus vraiment de sens.
Enfin, moins vous fixez de « cadre », plus vous augmentez la probabilité d’accéder à la sérendipité (trouver une idée que l’on ne cherchait pas ou par erreur, tels que le post-it, le four à micro-ondes ou encore la pénicilline). Aussi paradoxal que cela puisse paraître, c’est souvent quand on ne cherche pas que l’on trouve…
3 exemples de pratiques qui favorisent la créativité et l’innovation
- En France, chez Orange (seul opérateur qui n’a pas été percuté par la vague Free – hasard ou coïncidence ?), les salariés peuvent exprimer librement leurs idées via un système d’innovation sociale intitulé IdClic. Le processus permet à n’importe quel salarié, quel que soit son statut, son ancienneté ou son métier de déposer une idée sur une plateforme d’engagement. L’idée est étudiée par des experts volontaires (environ 5 000). Si elle n’est pas archivée (aucune idée n’est considérée comme mauvaise), elle fait l’objet d’une étude de faisabilité avec une estimation des gains nets. Une fois mise en exploitation (l’auteur de l’idée fait partie du projet) elle peut être, selon les bénéfices, déployée au niveau national. Le collaborateur se voit attribué des talents (monnaie virtuelle) qu’il utilisera dans une « boutique dédiée. Depuis 2007, 1/3 des collaborateurs ont déposé une idée (soit environ 122 000 idées déposées). 10 % ont été déployées générant ainsi plusieurs centaines de millions d’économies qui n’aurait pu être occasionnées autrement.
- Aux Etats-Unis, chez 3M, l’entreprise pratique encore le principe des 80/20. Initiée dans les années 30, son PDG de l’époque, William McKnight, avait un crédo : « Embaucher les bonnes personnes, et les laisser faire ». C’est la raison pour laquelle il a instauré une pratique visant à permettre aux salariés qui le souhaitent de consacrer environ 20 % de leur temps (soit 1 jour par semaine) à travailler sur des projets de leurs choix (en dehors du cadre hiérarchique). Cette démarche a permis de donner naissance à des produits tels que le post-it inventé par 2 chimistes salariés en 1974 (3M vend aujourd’hui plus de 600 produits de type post-it). Cette pratique a par la suite été reprise par d’autres entreprises telles que Google ou Atlassian.
- Aux Etats-Unis, constatant une augmentation des critiques de ses produits sur la toile, le PDG de DELL, Michael DELL a décidé en 2007 de créer une plateforme internet, intitulée IdeaStorm, via laquelle il a demandé aux internautes de poster les critiques qu’ils voulaient formuler envers ses produits. Cette démarche, certes audacieuse et courageuse (pas très Frenchy vu notre aversion pour l’échec et les erreurs), a permis à cette entreprise d’identifier les causes d’insatisfaction afin d’apporter des solutions. La seconde étape a consisté à associer les clients dans la recherche de nouvelles idées, ce que l’on appelle désormais « l’open innovation ». Certaines idées ont été retenues parmi les 9 000 suggérées. Cette initiative a également permis de renouer le lien avec les clients. Pour trouver de nouvelles idées, il faut élargir le périmètre de suggestions en dehors de l’entreprise. A dire vrai, qui n’aimerait pas contribuer gracieusement à l’essor d’une entreprise que l’on apprécie lorsqu’il n’y a aucun enjeu personnel. Ne serait-ce pas là les prémices du « don d’idées » ? Mais Dell n’est pas seul à s’être engagé dans cette voie. Des entreprises telles que Lego, IBM ou Auchan sont depuis de la partie.
Les 5 étapes pour réinventer son management
1. Eprouver réellement et sincèrement le besoin de changer
Il existe 2 principales raisons pour lesquelles les entreprises s’engagent dans ce type de démarche :
- La première est en réaction face à un danger, une crise ou une contrainte d’envergure qui remet en cause la pérennité de l’entreprise comme ce fut le cas pour Poult, Lego ou IBM.
- La seconde est le fruit d’une conviction d’un leader « iconoclaste » tel que Bill Gore, Vineet Nayar, Ricardo Semler ou Jean-François Zobrist.
Quoi qu’il en soit, et compte tenu des impacts que cela va avoir sur tous les acteurs de l’entreprise, la remise en cause des pratiques managériales ne doit pas être un effet de mode. On voit bien l’inefficacité de certains outils collaboratifs lorsque la gouvernance ne le désire pas vraiment.
2. Communiquer ouvertement et avec transparence son intention
L’innovation managériale est avant tout d’ordre culturel. Elle impacte les valeurs, les croyances, les comportements et modifie généralement en profondeur les pratiques héritées du siècle dernier (se faire évaluer par des inconnus comme cela se pratique chez HCLT a de quoi perturber si l’on adhère pas à l’état d’esprit bienveillant sous-tendu par cette démarche).
Pour susciter l’adhésion, il importe d’être le plus clair possible sur les raisons de cette évolution, d’expliquer son ambition et de les communiquer avec authenticité et transparence pour pouvoir inviter les salariés à s’impliquer dans cette évolution, comme l’a fait Leroy Merlin avec son projet Vision.
Bien évidemment cela suscitera des réactions de la part des plus sceptiques mais il vaut mieux traiter les réactions que d’être modéré sur sa vision. Par expérience, les personnes qui n’adhéreraient pas à cette nouvelle vision (et notamment les cadres) n’auront d’autre que choix que de quitter l’entreprise. Zappos a mis en place un processus d’intégration de ses nouveaux collaborateurs au cours duquel elle présente l’entreprise. Au bout d’une semaine, les nouveaux embauchés sont soumis à un choix : soit rester dans l’entreprise, soit quitter l’entreprise avec une prime exceptionnelle de 2 000 dollars (qu’ils ne percevront pas s’ils décident de démissionner plus tard). Cette pratique a pour but d’inciter les nouveaux collaborateurs à se positionner sur leur niveau d’adhésion au fonctionnement et à la culture d’entreprise.
3. Créer le besoin de changement
Cette étape consiste à autoriser et encourager l’expression de problèmes que tout le monde connaît mais qui sont rarement évoqués ouvertement (Qu’est-ce qui nous empêche de… ? Quelles difficultés rencontrons-nous ?). En d’autres termes, l’entreprise doit inviter les salariés à formuler leurs problèmes, insatisfactions, objections ou doutes, puis y répondre, comme l’a fait HCLT à travers son système U&I.
Il se peut que certaines questions restent sans réponses. Peu importe, le plus important n’est pas de trouver la bonne solution mais de modifier la culture de manière à transformer les problèmes en opportunités d’amélioration de l’existant.
Le plus important à ce stade est de concentrer les problèmes et insatisfactions dans un espace dédié de manière à en avoir progressivement la maîtrise plutôt que de les laisser se répandre dans les couloirs ou autour de la machine à café.
Pour soutenir cette dynamique, il est préférable de préparer les managers (via un séminaire ou des groupes de travail) à adopter une nouvelle posture et notamment à quitter le costume de l’omniscience pour endosser celui de « manager coach » (accompagnement et soutien).
Libérer la parole suppose 2 qualités. Tout d’abord le courage. Il n’est pas évident pour le management d’entendre des critiques et d’être remis en cause. Mais la critique n’est pas forcément un jugement. Elle peut être aussi un point de départ d’un renouveau. Il faut accepter que tout ne soit pas parfait ou que ce qui était un atout par le passé puisse devenir une limite pour le futur.
La seconde qualité est l’humilité, à savoir accepter et faire accepter le principe que le management ne sait pas tout. Le mythe du manager omniscient est à l’origine de beaucoup de problèmes dans nos entreprises (démotivation du manager, évitement de certains problèmes, critiques de collaborateurs, déresponsabilisation suite à une erreur…). Oser dire à son équipe qu’on ne sait pas mais que l’on compte trouver une solution ensemble est par expérience extrêmement libérateur pour les managers… et les collaborateurs.
4. Mobiliser l’intelligence collective
Résoudre les problèmes ou trouver de nouvelles idées ne dépend plus de modèles élaborés par des consultants de renom (il n’y en a plus) mais repose à présent sur la capacité des entreprises à faire émerger et valoriser les idées du plus grand nombre.
Cette étape consiste à élargir le « champ d’expression des idées » à tous les niveaux de l’entreprise. Elle suppose de s’émanciper du paradigme selon lequel seuls les experts ou la hiérarchie ont de bonnes idées.
Des entreprises telles qu’Orange, Google ou Lego ont su innover en permettant au plus grand nombre d’exprimer leurs idées par le biais des systèmes informatiques dédiés, soit internes (IdClic d’Orange, GoogleIdeas…), soit externes (IdeaStorm de Dell, Mindstorm de Lego…).
Il est fréquent que cette étape génère une certaine résistance de la part du management qui se voit en quelque sorte déposséder de son pouvoir d’initiative, voire décisionnel. Tel fut le cas pour une grande entreprise dont le PDG a validé une idée exprimée par un technicien qui a remis en cause un projet d’un dirigeant (et qui a fait gagner des millions à son entreprise).
Tout le monde ne voudra pas jouer le jeu mais ce n’est pas votre objectif. Votre but est de permettre à vos alliés et ceux qui ont des idées de pouvoir s’exprimer et s’impliquer dans votre projet. N’oublions pas que le but du jeu est de convertir les 61% de non engagés en engagés. Laissez les opposants là où ils sont. Lorsque la « masse critique de succès » sera atteinte, les opposants à la nouvelle culture managériale n’auront plus d’autre que choix que d’adhérer ou de se démettre. La force du collectif est nettement supérieure à celle du statut.
5. Instituer des communautés
Décloisonner sans pour autant modifier l’organigramme s’obtient par l’instauration de « communautés d’engagement ». En d’autres termes vous pouvez mobiliser vos collaborateurs, sur la base du volontariat (c’est primordial), sur un certain nombre de thèmes, que ce soit pour renforcer les liens ou le partage d’expériences autour de missions communes, tel que le fait la SNCF avec sa « communauté managériale », de problématiques sans solutions connues, comme le pratique le S.D.I.S. 71, d’expérimentations comme le fait Facebook ou encore pour créer de la convivialité autour de sujets extra-professionnels, comme c’est le cas chez Accenture.
Outre le décloisonnement, cette démarche permet de renforcer l’agilité par la mise en relation de collaborateurs volontaires et bienveillants. Elle représente une bonne opportunité pour les entreprises qui seraient freinées par des acteurs réfractaires au changement.
Réinventer son management : les vraies fausses bonnes raisons de ne le pas le faire
Si la plupart des entreprises avouent être séduites par toute ou partie de ces innovations, la quasi majorité recule lorsqu’il s’agit de s’engager dans la réinvention de leurs pratiques, au motif que :
- « elles ne sont pas encore prêtes » (lorsqu’elles le seront, ne sera-t-il pas trop tard ?),
- « chez nous c’est différent » (en quoi ? rencontrez d’autres entreprises et listez les points communs. Vous constaterez que, si les métiers ne sont pas les mêmes, les modes de collaboration sont quasiment identiques),
- « cela va être compliqué de faire changer les mentalités » (c’est là tout l’enjeu),
- « les instances représentatives du personnel s’opposeront très certainement aux changements de pratiques managériales » (pourquoi les représentants du personnel verraient un inconvénient à renforcer le bien-être, la confiance, l’autonomie ou encore la cohésion de ceux qu’ils représentent ?),
- « on n’a pas de budget » (en quoi demander à des collaborateurs d’évaluer leurs managers nécessite de l’argent ?)
DRH, acteur majeur de l’innovation managériale. Oui, mais comment ?
Si l’innovation est traditionnellement dédiée à la fonction recherche & développement, le pilotage des évolutions, réformes, révolutions managériales sera très probablement confiée à la fonction ressources humaines, comme ce fut le cas pour la responsabilisation sociale/sociétale ou plus récemment pour le management des risques psychosociaux.
Cependant, alors que les professionnels de la fonction R.H. étaient soutenus par l’évolution de la réglementation sociale (Accord National Interprofessionnel contre le stress, Obligation à venir sur l’entretien professionnel tous les 2 ans…) ou la légitimité de concepts outre atlantique (matrice SWOT, objectif SMART, reengineering…), il n’en sera pas de même en ce qui concerne l’innovation managériale, bien au contraire, car les évolutions seront propres à chaque entreprise, en fonction de l’écart entre sa culture actuelle et de son ambition de changement.
La remise en cause des pratiques actuelles sera très certainement au début mal perçue par un certain nombre d’acteurs de l’entreprise. Certains dirigeants n’accepteront pas de voire leur autorité modifiée, certains experts ne vivront pas bien le fait que tout le monde puisse mettre un nez dans leurs pratiques, certains partenaires sociaux craindront de voir leur représentativité s’évaporer au détriment d’un rapprochement entre encadrement et collaborateurs, certains qualiticiens opposeront une « non conformité » aux principes de la qualité, les organisateurs contesteront la suppression des outils qu’ils auront mis des années à instaurer et certains juristes déclencheront l’alerte rouge par rapport au code du travail, conventions collectives ou accords d’entreprises.
Bref, ce changement sera sans doute le plus difficile que les D.R.H. auront a piloter, tout simplement parce que cette discipline vient contredire bon nombre de paradigmes managériaux fortement ancrés depuis plus d’un siècle.
Si la fonction ressources humaines se verra confiée le pilotage de ces (r)évolutions, elle ne pourra pas se positionner en expert comme ce fut le cas pour les classifications, les référentiels compétences ou les démarches d’évaluation. Son rôle sera principalement de créer les conditions d’une réforme culturelle, de fédérer, d’encourager, de rassurer, de faciliter, de soutenir et de valoriser les succès, de relativiser les échecs.
Les D.R.H. devront se montrer exemplaires et progressivement céder la place à des dirigeants convaincus qui deviendront les principaux « maitres à bord » et les ambassadeurs de nouvelles pratiques, plus démocratiques, plus collaboratives.
Il leur faudra faire preuve à la fois d’audace et d’humilité, d’enthousiasme et de patience, de structuration et de souplesse et surtout d’inventivité pour impulser cette transformation. Mais n’est-ce pas ce à quoi était destinée cette fonction ?
Francis Boyer