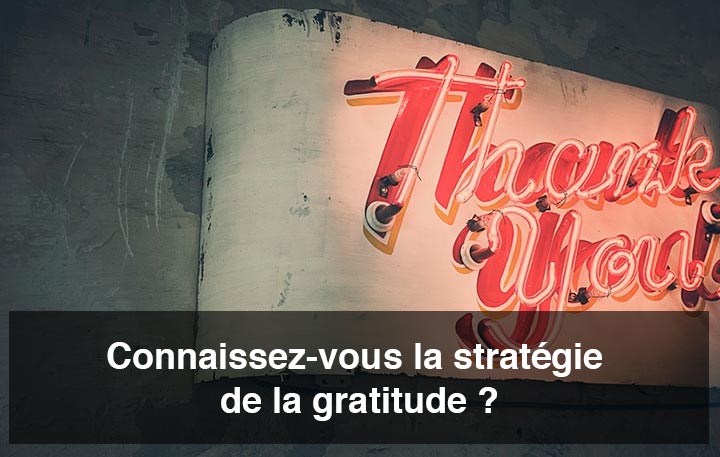C’est une question que tout le monde s’est posée à un moment dans sa vie d’entrepreneur : faut-il que je détienne mes actions en nom propre ou via une holding ? Les réponses du Galion Project. (Article initialement publié sur le blog du Galion Project).
Après avoir interrogé un certain nombre de fondateurs Galion, nous nous sommes rendus compte que ce choix n’avait rien d’évident. En fait, environ la moitié avait opté pour garder tous leurs titres en direct, tandis que l’autre moitié en avaient logés tout ou partie dans une holding personnelle.
Bref, c’était l’occasion de faire un point sur une question qui peut avoir un impact important sur la taxation au moment de la vente de ses parts, ce à quoi tout entrepreneur est forcément (un peu) sensible.
Comme tout ce qui touche à la fiscalité, cela nécessite d’avoir une vision chiffrée d’autant plus précise que le cadre réglementaire a tendance à changer (trop) souvent. Pour s’assurer que nous avions les bons paramètres en main, nous nous sommes appuyés sur l’expertise de Thierry Chouvelon et Stéphane Gandemer de la banque privée UBS France qui suit au jour le jour l’évolution de la réglementation et de la doctrine de l’administration fiscale. Nous les remercions pour leur soutien sur cette étude.
Dans tout le document, on est parti du principe que l’entrepreneur est résident fiscal français.
La fiscalité sur les actions en nom propre
Avant de s’intéresser au cas des holdings, faisons un rappel sur la fiscalité en cas de détention des actions en nom propre qui – malgré une certaine complexité – reste le cas le plus simple.
Suivant une promesse de campagne, le gouvernement Hollande a décidé un changement majeur de philosophie sur la fiscalité des plus-values sur le capital. En lieu et place d’un régime à part, les plus-values sur le capital sont désormais considérées comme un revenu au même titre que le salaire.
Pour les faibles plus-values, cela peut faire un taux plus bas que dans l’ancien système, voire nul pour les cas les plus modestes. Néanmoins pour les entrepreneurs Galion qui espèrent une plus-value qui se compte en millions d’euros, on rentre automatiquement dans la tranche marginale de l’impôt sur le revenu, soit 45%. A cela, il faut ajouter 15,5% de prélèvements sociaux et un 4% supplémentaire joliment appelé « contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ». Cette dernière taxe instaurée sur le gouvernement Sarkozy n’a d’exceptionnelle que le nom. Elle a en fait été maintenue par Hollande et on peut partir du principe qu’elle est durablement inscrite dans le paysage fiscal.
Au final, en additionnant ces 3 facteurs, on arrive à un taux marginal de 64,5%.
Ce taux facial, un des plus élevés du monde contemporain, a servi d’épouvantail et a déclenché le mouvement dit des Pigeons. Suite à cela, deux éléments importants ont été introduits pour adoucir (fortement) les choses :
i.Un régime dérogatoire pour les PME de croissance.
La définition de ce régime est très large et permet facilement à tous les entrepreneurs Galion d’y qualifier. Pour cela, au moment de l’acquisition des titres par le fondateur, la société doit :
- avoir moins de 10 ans
- être une création ex-nihilo et non une restructuration ou reprise d’activité existante
- avoir moins de 250 salariés et un total de bilan inférieur à 50 millions d’euros ou un chiffre d’affaire inférieur à 43 millions d’euros
Il faut en plus pendant toute la vie de la société que celle-ci :
- n’accorde aucune garantie en capital aux actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions
- qu’elle ait son siège dans l’Union Européenne
- qu’elle exerce une vraie activité commerciale
ii.Un abattement sur la durée de détention des titres
L’idée du législateur est de distinguer ce qui relève de la spéculation court terme de l’investissement à long terme. Dès qu’on dépasse 1 an de détention (ce qui est très court dans la vie d’une startup), le taux d’imposition commence à descendre de manière substantielle. Il y a différents paliers qui culminent après 8 ans de détention. 8 ans, cela peut paraitre long lorsqu’on crée sa startup, mais force est de constater que les plus beaux succès de la French Tech ont pratiquement tous mis plus de 8 ans à arriver à maturité. Oui il faut être patient pour bâtir une licorne !
En combinant le régime dérogatoire et 8 ans de détention, on bénéficie d’un abattement assez spectaculaire de 85%. Néanmoins, cet abattement ne s’applique que sur l’impôt sur le revenu et non les prélèvements sociaux et la contribution exceptionnelle, qui eux s’appliquent dans tous les cas sur l’assiette complète. C’est d’ailleurs une tendance assez générale que les prélèvements sociaux soient exclus des nombreuses niches fiscales qui font les délices des conseillers en patrimoine.
Au final, au bout de 8 ans de détention, on arrive ainsi à un taux marginal tout compris de 26,25%. On voit qu’on est très loin des 64,5% initiaux. A titre de comparaison, en Californie, paradis des entrepreneurs, la fiscalité sur les actions fondateurs est de 37%.
Enfin pour être complet, il faut mentionner que l’administration fiscale dans sa grande sagesse a rajouté une petite carotte supplémentaire en permettant de déduire 5,1% de CSG l’année N+1 de l’opération de cession.
Prenons un exemple sur une cession avec une belle plus-value de 20 millions d’euros.
Par souci de simplicité, on va faire comme si toute la plus-value était imposée au taux marginal, sachant qu’en réalité on gratte des abattements supplémentaires liés à la progressivité de l’impôt sur le revenu. Après abattement de 85%, il reste 15% sur lequel s’applique la tranche marginale de 45% de l’impôt sur le revenu, soit un taux effectif de 6,75 %. En parallèle sur 100% de la plus-value, on a 15,5% de prélèvements sociaux et 4% de contribution exceptionnelle (là encore on ne prend que la tranche marginale par soucis de simplification, mais en réalité cette contribution est progressive).
On se retrouve donc avec un imposition totale de 5,25 millions d’euros, soit nos 26,25% ci-dessus.
L’année suivante le cédant a la possibilité de déduire 5.1% soit 1,02 million d’euros de ses revenus. A supposer que notre contribuable-entrepreneur soit encore en tranche marginale d’impôt sur le revenu (ce qui est souvent le cas notamment si on reste travailler pour l’acquéreur et qu’on a eu la présence d’esprit de négocier un bon salaire, voir un bon earn-out), il économise donc : 45% d’impôts soit 0,459 million d’euros.
Cela ramène donc son imposition totale à 4,791 millions d’euros, soit un taux réel de 23,95% (légèrement surévalué due à la progressivité mentionnée ci-dessus).
Le régime fiscal des holdings
Si la fiscalité personnelle s’est grandement améliorée, à première vue le régime fiscal de la holding paraît encore plus magique. Dans le cas de figure le plus favorable, on peut bénéficier d’un taux d’impôt incroyable de 4%, digne d’un des meilleurs paradis fiscaux de la planète.
Alors pourquoi hésiter ?
Parce que bien sûr, ce taux exceptionnel vient avec un certain nombre de contraintes, et si on se prend les pieds dans le tapis fiscal, il peut grimper très vite à des niveaux qui peuvent faire regretter le montage.
Tout d’abord, il faut bien comprendre qu’il y a une différence notoire entre avoir de l’argent sur son compte personnel et de l’argent logé dans une holding. Dans le premier cas, on peut l’utiliser comme cela nous chante, tandis que dans le second cas, il faut veiller à ce que l’utilisation soit conforme à l’objet social de la holding. Sinon on risque tout simplement l’abus de bien social.
Bien sûr, il est toujours possible de sortir de l’argent de sa holding sous forme de dividendes. Mais ce versement est considéré comme un revenu et imposable en tant que tel. Le législateur qui a souhaité ménager les (vieux) rentiers, a certes permis à ce revenu particulier de bénéficier d’un gentil abattement de 40% sur le montant des dividendes bruts perçus, ce qui conduit à une imposition pouvant atteindre 44,2% ou 48,2% si on rajoute les 4% initiaux.
Il est aussi possible de sortir de l’argent de sa holding au moyen d’un rachat par celle-ci de ses propres titres suivie de leur annulation. Le gain lié à cette opération suit le même régime que les plus-values de cession de titres. Néanmoins, comme il s’agit d’une holding patrimoniale, on ne bénéficie plus du régime dérogatoire. Par exemple, au-delà de 8 ans de détention, l’abattement sera limité à 65% contre 85%, ce qui avec les prélèvements sociaux donne un taux marginal de 35,25%. Au final, on se retrouve à payer plus d’impôts que si on avait détenu les titres de sa startup en direct dès le départ.
Certains voient aussi la holding comme une sorte de sas de décompression permettant de stocker le prix de cession et d’étaler la fiscalité dans le temps sous forme de dividendes annuels. Même si c’est fiscalement moins optimal, cela peut être psychologiquement rassurant de payer ses impôts au fil des vrais besoins de son train de vie, plutôt que tout d’un coup au moment de la vente.
Néanmoins cette stratégie d’étalements multi-annuels des dividendes prive l’entrepreneur d’un autre avantage extraordinaire de notre système fiscal, le plafonnement de l’ISF. Tout entrepreneur qui vend bien sa startup a en effet toutes les chances de se retrouver assujetti à l’ISF sur les tranches élevées du barème. Or il existe un moyen simple d’échapper complètement à cet impôt bien moins méchant qu’il n’y parait : il suffit de vivre de son capital et de ne pas se verser de revenus.
Par exemple, pour un entrepreneur qui a un patrimoine net 20 millions d’euros, il est censé payer chaque année environ 250k€ en ISF. Mais s’il a pris soin de vivre de son capital (en capitalisant ses revenus sans y toucher), la facture ISF est ramenée à zéro, car elle ne peut pas dépasser 75% des revenus qui dans son cas sont inexistants. On voit tout de suite que plus on dispose d’un capital important, plus il est facile d’appliquer cette stratégie d’évitement. Une magnifique illustration que l’ISF est un impôt pour les riches, mais pas pour les… très riches.
Bref on l’a compris, si on se lance dans une holding, pour optimiser sa fiscalité il faut éviter de sortir trop d’argent de cette tirelire dorée. Dans la pratique, on est souvent condamné à une sorte d’épargne forcée sur sa holding. Pas étonnant que les banquiers adorent les holdings patrimoniales où ils ont tout loisir de déployer leur expertise en placements. Qui veut devenir le plus riche du cimetière ?!
Comme on l’a découvert au Galion, la plupart des entrepreneurs ne vivent pas seulement d’amour et d’eau fraiche, surtout après la vente de leur startup. La solution pragmatique consiste à garder une partie de ses titres en directe afin de couvrir son futur train de vie, le reste des titres étant logés dans une holding personnelle qui aura vocation à servir de véhicule d’investissement futur.
La répartition direct versus holding
Vient immédiatement la question : comment répartir ses titres entre la poche qu’il convient de détenir en nom propre et celle qu’on va loger dans sa holding ? Ce n’est pas si simple.
Tout d’abord, il faut se poser la question de combien on aura besoin pour couvrir son futur train de vie. Selon qu’on soit de nature frugal ou somptueuse, on peut arriver à un chiffre assez différent.
Mais surtout, cela dépend beaucoup de combien on va toucher sur la vente de sa startup. Si la plus-value est de 2 millions d’euros, on peut vite en arriver à consacrer l’essentiel de ses gains à sa vie personnelle. Si par contre, on touche 30 millions d’euros, on peut facilement se dire qu’on va consacrer les deux tiers, voire plus, à des investissements futurs.
On en vient à la question fondamentale du timing de création de cette fameuse holding.
i.Cas de la holding créée juste avant la vente de la startup
Comme le montant du chèque de sortie est une variable clé, le premier réflexe est de se dire qu’on va créer cette holding juste avant de vendre sa startup. Comme ça, on aura une idée très claire du montant à mettre dans chaque poche.
A ce stade, il convient de rentrer dans la mécanique de création de la holding. Concrètement, l’entrepreneur va créer une nouvelle société NewCoPerso dont il est l’actionnaire unique et va apporter à cette NewCoPerso les titres qu’il détient en direct dans sa startup.
La beauté de l’opération est que s’il a bien pris soin que sa NewCoPerso soit au régime de l’impôt sur les sociétés (IS), l’entrepreneur bénéficie d’un report d’imposition sur l’opération d’apport. Cela veut dire que même si techniquement il « vend » ses titres à sa holding, il n’est pas tenu de payer immédiatement d’impôt sur la plus-value. A noter que cette disposition ne va pas de soi et que ce report d’imposition constitue une des nombreuses douceurs du système fiscal français (tant décrié). Par exemple, ce type de report n’existe pas aux Etats-Unis où l’apport de ses titres à une holding est un évènement taxable immédiatement (on y reviendra).
Comme la holding NewCoPerso a été créée juste avant la vente, elle va elle-même céder les titres de la startup à une valeur identique à la valeur d’apport, donc aucune plus-value n’est extériorisée sur la holding. Wow, miracle, on est pour l’instant à 0% d’imposition !
Néanmoins, au moment de la vente des titres de la startup par la holding, cela est censé faire tomber le report d’imposition et l’entrepreneur doit payer sa fiscalité personnelle. Dans ce cas, on ne voit pas trop l’intérêt du montage, puisqu’au final, l’entrepreneur aura payé ses impôts comme s’il détenait ses titres en direct tout en ayant les contraintes de l’agent coincé dans sa holding.
En fait, il existe une disposition intéressante qui permet de prolonger le report d’imposition. Pour cela, il faut s’engager à réinvestir au moins 50% du produit de cession dans une activité commerciale et ceci dans les deux ans qui suivent la cession. De plus, les investissements réalisés doivent être conservés au moins pendant 2 ans.
La beauté du montage est que la prolongation du report n’a pas de limite de durée. Une fois les conditions ci-dessus respectées, le seul événement qui provoquera la déchéance du report est la cession totale ou partielle de la holding. Par cette disposition étonnante, le législateur a bien sûr voulu (pour une fois) favoriser l’investissement productif et non les rentiers. Qui a dit que la France n’était pas un paradis fiscal pour les entrepreneurs ?!
Pour être bien clair, on ne parle pas ici d’acheter de l’immobilier ou de se constituer un portefeuille en bourse. Il faut soit créer une nouvelle startup, soit souscrire à une augmentation de capital d’une startup existante, soit racheter une participation majoritaire.
En revanche sur le solde des liquidités de la holding après le réinvestissement d’au moins 50% du produit de la cession, on a toute latitude d’investissement en terme de produits financiers ou immobiliers.
Deux ans pour réinvestir, cela parait long, mais en fait c’est très court. Par exemple, si on a logé 20 millions d’euros dans sa holding, il faut réinvestir au moins 10 millions d’euros dans les deux ans, sinon le report d’imposition tombe sur l’ensemble de la plus-value. Investir 10 millions d’euros en deux ans dans des startups, ce n’est pas si simple. C’est un vrai métier qui ne s’improvise et prend du temps. C’est d’autant plus compliqué si l’entrepreneur a une clause de lock-up qui l’oblige à continuer à travailler à plein temps pendant toute cette période dans son ancienne startup, ce qui est très fréquent. Le risque est que l’obsession de garder le report d’imposition pousse à prendre des risques déraisonnables et au final à perdre plus d’argent que la carotte fiscale initiale.
Bref, avant de transférer massivement ses titres dans une holding la veille de la vente de sa startup, mieux vaut avoir déjà une idée très claire de ce qu’on veut faire dans les deux ans à venir.
ii.Cas de la holding créée au démarrage de la startup
Pour éviter une cavalcade frénétique sur les réinvestissements suivant la vente de sa startup, il existe une autre tactique. Cela consiste à loger ses titres dans sa holding personnelle NewCoPerso dès la création de sa startup.
Dans notre arsenal fiscal qui décidément révèle bien des surprises, il existe en effet une disposition intéressante qui stipule que si la holding NewCoPerso a détenu les titres pendant au moins 3 ans, on est dispensé de la contrainte temporelle sur le réinvestissement. En créant sa holding au démarrage de sa startup, on a donc une forte chance de se libérer de cette contrainte.
Évidemment, au moment du démarrage, le fondateur n’a aucune idée du montant qu’il va toucher à la sortie, donc la répartition entre la poche personnelle et la poche à réinvestir sera un peu arbitraire. Rien n’est parfait, mais ce n’est pas tout.
Avec la holding NewCoPerso qui a acquis les titres de la startup au nominal au démarrage, elle fera bien sûr la plus-value complète au moment de la vente de la startup. C’est là que le taux de 4% mentionné plus haut prend toute son importance.
Comme toutes les sociétés, NewCoPerso est taxée à l’impôt sur les sociétés (IS) au taux de 33,3%. Mais dans le cas des holdings, cette taxation ne s’applique que sur une assiette de 12% des plus-value de cession, qui est censée correspondre à une quote-part de frais et charges (tout à fait fictive entre nous dans le cas d’une holding personnelle, mais le principe est accepté par l’administration fiscale qui en la matière est étonnamment accommodante). D’où le taux marginal d’imposition effectif qui descend à cet étonnant 4%.
Néanmoins, pour bénéficier de ce délicieux statut fiscal de holding, il y a une contrainte importante : il faut que NewCoPerso détienne au moins 5% de la startup au moment de la vente. Lorsqu’on crée sa startup, cela parait un niveau assez faible, mais avec les tours de financement successifs, il est courant pour certains fondateurs de descendre sous ce seuil fatidique. A fortiori si l’entrepreneur a décidé de ne mettre qu’une partie de ses titres dans sa NewCoPerso.
On imagine très bien la situation où l’entrepreneur va se trouver devant le choix cornélien de soit refuser un tour de financement indispensable pour la croissance de sa startup, soit accepter de passer sous le seuil des 5%, ce qui le conduira à une taxation à 33,3% sur l’ensemble des titres de sa holding, soit nettement plus que s’il les avait gardé en direct. De belles nuits blanches en perspective.
iii. Cas de la holding créée en cours de vie de la startup
C’est là que les malins se disent, pourquoi ne pas créer la holding en cours de vie de la startup, une fois celle-ci a atteint un certain stade de maturité ? Avec un peu de chance, on va pouvoir optimiser les choses au mieux.
Cela permet en effet d’avoir une bien meilleure visibilité qu’au démarrage à la fois sur la trajectoire de la startup.
Pour décider du nombre de titres à mettre dans sa holding, il faut se poser la question : dans un scénario réaliste, est-ce que mon espérance de gain se situe plutôt en millions ou en dizaines de millions ?
Pour estimer le risque que cette NewCoPerso tombe sous le seuil de 5%, il faut se demander : combien faut-il pour atteindre le break-even et à quelle valorisation je peux espérer obtenir cet argent ?
A ce stade, il reste une inconnue de taille qui peut avoir un impact important sur le niveau de taxation : à quelle date se fera la cession ? C’est une question à laquelle il est souvent difficile de répondre en cours de vie de la société, car même s’il n’y a rien à l’horizon, un acheteur peut survenir à tout moment et vouloir conclure une vente en quelques semaines. Dans ces cas, il faut savoir saisir sa chance, car les plats ne repassent pas toujours deux fois.
Pourquoi le timing de la vente est-il si important ?
C’est qu’en fait, pour bénéficier encore une fois du statut fiscal privilégié de la holding concernant les plus-value, il faut que la holding ait détenu les titres depuis au moins 2 ans. Sinon la plus-value de la holding sera taxée au taux plein à 33,3%. Cette taxation s’apprécie bien sûr uniquement sur la plus-value de la holding, donc par rapport au prix d’apport des titres à la holding (qui en cours de vie de la startup va en général se caler sur celui du dernier tour de financement avec un léger discount si celui-ci était en actions de préférence).
On voit que le cas de figure le plus défavorable est celui d’une vente dans les 2 ans qui suivent le montage, si pendant cette durée la startup s’est fortement valorisée (ce qui en principe est un scénario que tout le monde souhaite). Le fondateur se retrouve à payer l’IS plein à 33,3% sur la plus-value de la holding. Comme il est aussi dans la fenêtre de 3 ans, il est aussi contraint de réinvestir 50% de la plus-value pré-transfert pour bénéficier du report d’imposition sur sa fiscalité personnelle.
Pour aller plus loin sur les holdings patrimoniales
Quelques éléments supplémentaires à avoir en tête avant de se lancer dans une holding patrimoniale.
Si on a pour projet à titre personnel de partir s’installer aux Etats-Unis (pour beaucoup de startup Galion, c’est un enjeu stratégique majeur), il faut complètement oublier les holdings. En effet, non seulement les carottes fiscales décrites ci-dessus n’ont pas d’équivalent aux US, mais les Etats-Unis appliquent une transparence fiscale totale sur les holding personnelles. De fait, cela revient à subir une double taxation (le 4% vient en supplément de la fiscalité personnelle), ce qui n’est vraiment pas l’idée recherchée !
La mise en place d’une holding complique légèrement le pacte d’actionnaire avec les investisseurs, sans que cela ne soit du tout rédhibitoire. Ils voudront simplement s’assurer que cela ne distorde pas l’esprit du pacte, ni que ce soit un moyen de contournement de certaines clauses. Pour que cela se passe bien, il convient de ne pas être trop créatif et de garder une structure personnelle à vocation purement fiscale. A éviter : faire entrer sa famille ou ses amis dans sa holding personnelle ou utiliser cette holding pour faire d’autres montages.
Les holdings exotiques dans les paradis fiscaux sont une complication supplémentaire pour un intérêt assez limité. Tant qu’on est résident fiscal français, cela n’a aucun impact sur sa propre taxation personnelle, et le régime français est tellement favorable qu’il est difficile de trouver vraiment mieux ailleurs. L’intérêt se situe essentiellement en aval de la vente, afin de bénéficier d’une fiscalité réduite sur les futures plus-values de placements financiers. Mais cela oblige à avoir une vraie substance dans ces montages. En clair, cela nécessite de se rendre régulièrement sur place. Dans un monde où les rendements financiers sont de toute façon bas, a-t-on vraiment envie d’aller plusieurs fois par an au Luxembourg (sous la pluie) pour économiser au mieux quelques milliers d’euros ? La vie est courte et mieux vaut faire du kite avec le Galion.
Jamais un acheteur d’une startup ne va racheter votre holding personnelle. Ce n’est pas son intérêt.
Enfin la mise en place d’une holding entraine un certain nombre de frais administratifs. A l’échelle des enjeux fiscaux sur une belle sortie, cela ne pèse pas grand-chose. Par contre, si l’aventure se révèle un désastre (ça arrive), ces frais deviennent tout de suite moins sympas pour les finances personnelles.
par The Galion Project