Si l’on en croît la vulgate de certains “experts” journalistiques ou marketing, écrire pour le web requiert un savoir-faire complexe et bien précis. Il s’agirait de suivre des règles incontournables si l’on veut plaire au lecteur et faire de l’audience.
1- IL FAUT ECRIRE COURT SUR INTERNET
Ce point est soulevé par Morgane Tual dans son dernier coup de gueule via lequel elle raille ces formateurs sexagénaires débitant ce genre de règle absurde avec une “certitude insensée”.
Ecrire court à tout prix alimente l’idée qu’on ne peut pas créer de la profondeur sur Internet, que tout est forcément superficiel et creux. Difficile d’expliquer le rigorisme de l’impératif kantien en 140 signes…
En réalité, il ne faut pas écrire court, il faut écrire “dense” : dire un maximum de choses avec un minimum de mots. Mais ceci n’a rien de spécifique au web. Cela est vrai de toute écriture digne de ce nom, journalistique ou pas, qui distingue du contenu riche du verbiage, comme d’une bonne ou d’une mauvaise copie de philo.
Mais écrire dense, cela veut dire avoir des choses à dire, avoir de l’information, des faits à délivrer. Je me souviens de cette responsable d’un magazine spécialisé assistant à l’une de mes formations, qui contesta ma recommandation de concision. Alors que j’insistais sur la nécessité d’aller à l’essentiel, de servir le lecteur en lui mâchant l’information utile, elle objecta: “nous, on doit remplir du papier, le lecteur en veut pour son argent, il lui faut ses 130 pages”.
En réalité, le verbiage avait surtout pour fonction d’augmenter artificiellement la pagination rédactionnelle, pour augmenter le nombre d’insertions de pub. Mais en admettant que le facteur kilo joue aussi auprès des lecteurs, il fallait fournir en ce cas plus de contenus (informations, illustrations)… La dilution ne tient que sur des segments presse peu concurrentiels, monopoles ou oligopoles qui ne durent pas éternellement.
Il faut certes adapter l’aspect visuel des contenus pour faciliter la lecture en moyenne 25% plus difficile sur un écran si l’on en croit Jacob Nielsen, ergonome expert ayant étudié la questions.
Cela signifie éviter des paragraphes “pavés” de quinze ligne sans aération dans lesquels le lecteur ne veut pas “entrer”. Eviter aussi les phrases qui n’en finissent pas, emplies de virgules, de gérondifs et de participes présents.
2- LE WEB, C’EST FORCEMENT MULTIMEDIA
A l’heure d’Internet, l’écrit est dépassé, il faut proposer de la vidéo, des animations interactives, des “serious games” et éventuellement un mélange de tout cela.
Non, l’écrit n’a pas disparu, bien au contraire, la lecture en général se porte bien et le texte foisonne sur Internet, comme en témoigne l’explosion des bases de données, textuelles pour la plupart. La question n’est pas d’apporter de la vidéo ou une animation pour faire “moderne” ou être dans la “tendance”, mais bien de savoir quel est le service rendu au lecteur.
Sous quel format, doit-on présenter l’information pour quelle soit la plus claire, la plus agréable, la plus facile à consommer ? Il n’y a pas de réponse unique à cette question, car les publics sont multiples. Pour certains, une interview vidéo sera le format le plus agréable. Pour d’autres au contraire qui ont peu de temps et préfèrent lire “en diagonale”, le texte sera plus adapté. On sait par ailleurs qu’une proportion importante de lecteurs sur Internet le fait depuis son lieu de travail, et tous n’ont pas un casque… Pour la discrétion ou l’open space, c’est donc un frein majeur.
En ce cas là, il semble judicieux de proposer les deux formats simultanés. Mais faut-il pour autant multiplier les formats ? Proposer tout en se disant que le lecteur fera lui-même son marché ?
Cette méthode faillit à l’une des missions essentielle du médiateur (ou “curator” selon le nouveau terme en vogue) : sélectionner l’information, la préparer pour la rendre digeste et servir ainsi le lecteur, d’autant plus qu’il est toujours plus submergé d’informations, de sollicitations visuelles, sonores, tactiles… olfactives demain ?
Le format retenu doit être fonction du propos. Pour raconter l’affaire Clearstream aux multiples rebondissements, une animation chronologique semble pertinente. Mais un schéma montrant les relations entre les différents acteurs ne sera-t-il pas plus efficace ? Et en tout état de cause le format choisi ne remplacera pas les articles anglés sur telle ou telle question: la manipulation de Lahoud, la contre-manipulation de Sarkozy, le rôle de Villepin, la complicité des grand patrons…
 le-petit-clearstream3- IL FAUT ECRIRE POUR LES MOTEURS
le-petit-clearstream3- IL FAUT ECRIRE POUR LES MOTEURS
J’ai déjà dénoncé ce reproche adressé souvent aux journalistes web selon lequel ils sont soumis au méchant Google qui leur impose des règles et du coup, formate l’information.
Si l’uniformisation des formes et contenus journalistiques n’est pas toujours une vue de l’esprit, la faute en incombe aux journalistes, pas à Google.
Google a conçu des règles pour répondre à un souci de pertinence, de service au lecteur. Ces critères ne sont pas parfaits, et sont de plus en plus détournés (rançon de la gloire). Mais ils fonctionnent globalement, sinon Google ne détiendrait pas 65% de parts de marché dans le monde, en dépit d’une concurrence acharnée de Bing/Yahoo notamment.
C’est peut-être justement au niveau des écoles de journalisme ou par imitation grégaire rassurante queles journalistes finissent par écrire tous de la même manière. Comme ils parlent tous de la même façon en télévision ou en radio. Norme évolutive si l’on se rappelle bien les tons nasillards de nos premiers speakers.
Les critères de Google : richesse syntaxique, mises en forme (gras, titres…), popularité sont des indices de qualité. Et Google ne punit pas les textes longs, bien au contraire, incapable de saisir la pertinence contextuelle d’un texte long ou court. Ainsi pour une dépêche d’agence, il semble pertinent pour servir l’utilisateur de faire court compte tenu de son mode de consommation limité dans le temps. Pour un article de blog, cela dépend de la richesse du contenu lui-même
Par ailleurs, les usages évoluent vite et ce qui est vrai aujourd’hui ne le sera plus demain. Ainsi des paginations horizontales limitées en 768 px de hauteur qui ont évolué d’abord avec l’augmentation des taux d’équipement en écran plus grands (du 15 au 19 pouces). Et ont été bouleversés ensuite par l’apparition de la molette sur les souris qui a fait éclore les navigations verticales à plat, sur l’initiative du précurseur 20 minutes. L’apparition des tablettes et du mobile va certainement changer encore les modes de lecture et de consommation de l’information.
Enfin, comme le rappelle Morgane, on tâtonne, on cherche, on teste… S’il y a bien une seule règle qui vaille, c’est celle de l’intérêt du lecteur qui appelle des réponses aussi diverses qu’il y a de publics différents.
4- IL FAUT METTRE UN MAXIMUM DE LIENS
Ajouter un grand nombre de liens, c’est bien pour le lecteur, car c’est lui offrir potentiellement plus d’informations. C’est d’ailleurs bien vis à vis des moteurs qui “récompensent” les liens internes et externes, indifféremment de leur nombre.
Oui, mais est-ce réellement un service au lecteur de l’étouffer sous l’information ? Pire encore sont ces liens automatiques générés à partir des tags qui noient les liens pertinents sous une masse d’autres inutiles ou éloignés du sujet principal.
Cette “infobésité” dessert le lecteur en lui faisant perdre du temps et en diluant le “sens” sous la masse d’informations.
Ce cas de figure est un exemple de l’arbitrage qu’il faut réaliser entre les fameuses règles de Google et l’intérêt du lecteur qui doit toujours rester la finalité.
5- LES SUJETS SERIEUX NE MARCHENT PAS
Les sujets sérieux, “high-brow topics” (haut du front), comme disent les Anglais ne fonctionnent pas. La politique, les sujets internationaux, tous thèmes profonds ne font pas d’audience.
Il faudrait au contraire ne fournir au lecteur que ce qu’il “demande”, à savoir des faits divers, du people, de l’insolite, du spectaculaire plus ou moins racoleur.
Il semble évident qu’une galerie photo sur les ravages du Tsunami fera plus d’audience qu’un dossier sur les subprimes. Mais rien n’empêche d’expliquer le principe de ces produits financiers lors d’un diaporama sur les raisons de la crise financière. Et mon expérience m’a prouvé que l’on peut faire de l’audience, certes pas dans les mêmes proportions, avec ce genre de sujets “sérieux”. Tout dépend du format, du propos, du contexte.
Car s’’il faut procurer au client-lecteur ce dont il a besoin, il faut aussi lui apporter ce dont il ne sait pas encore qu’il a besoin.
Le journaliste est aussi ce pédagogue qui, tout en satisfaisant son public, cherche aussi à l’instruire, à l’élever, l’air de rien, “par la bande”. Equilibre délicat où il convient de ne pas trop exiger de son lecteur pour ne pas trop se couper de lui. Sans tomber non plus dans le pur suivisme racoleur qui aboutit à un rejet tout aussi inéluctable, in fine.
Entre l’austère plat de haricots “politique internationale” et l’indigestion de bonbons Haribo “faits divers ou people”, il faut éduquer nos enfants-lecteurs à l’information. Cet équilibre complexe est ce qu’on appelle une ligne éditoriale
Les jeunes journalistes doivent donc prendre du recul par rapport aux règles qu’on leur dispense. Celles-ci ne sont pas paroles d’évangile, elles doivent être adaptées au cibles, au contexte de diffusion, aux sujets, au lieu de promotion dans le journal ou sur le site (page d’accueil, de rubrique ou de blog ?). Et garder à l’esprit que les usages changent vite et nécessitent surtout une écoute attentive pour s’adapter. Ainsi qu’une dose de créativité pour proposer. Un bon supermarché fournit rayons ET têtes de gondoles.
- Par Cyrille Frank, fondateur de Mediaculture.fr
- A propos
Cyrille Frank est journaliste. Fondateur de Mediaculture.fr et Quoi.info («l’actualité expliquée», devenu «ça m’intéresse»), il accompagne les médias dans leur mutation numérique. Formateur en marketing de contenus, stratégie éditoriale (augmentation de trafic, fidélisation, monétisation d’audience) et en usages des réseaux sociaux (acquisition de trafic, engagement…).













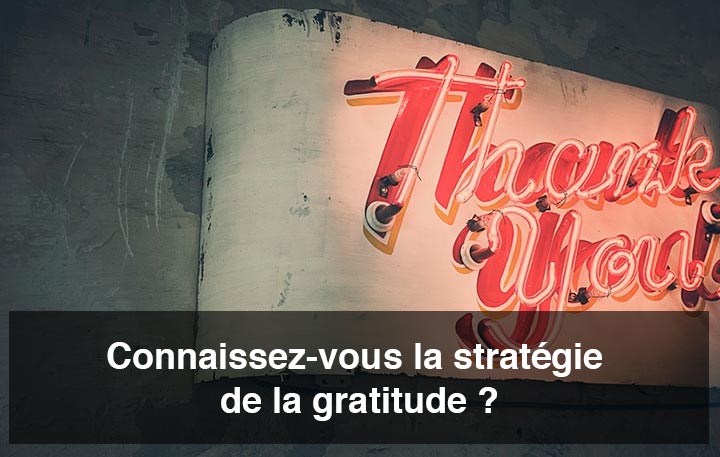

 Sachant que les identités sont de toute façon toujours protégées par clé privée, reste à savoir comment on stocke les données de l’utilisateur. Pour des raisons d’efficacité, certaines applications pourraient vouloir éviter la lourdeur du cryptage/décryptage.
Sachant que les identités sont de toute façon toujours protégées par clé privée, reste à savoir comment on stocke les données de l’utilisateur. Pour des raisons d’efficacité, certaines applications pourraient vouloir éviter la lourdeur du cryptage/décryptage. David Teruzzi est consultant blockchain. Il est co-fondateur de
David Teruzzi est consultant blockchain. Il est co-fondateur de 



